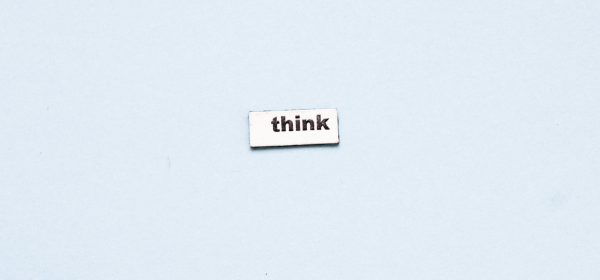Et si les seniors avaient tout pour être des champions de l’ère IA ?
Et si les seniors avaient tout pour être des champions de l’ère IA ?
Vu de loin, il semble que les développements de l’intelligence artificielle ne soient pas pour favoriser les séniors que l’on croit plus réticents au changement, plus inquiets pour la préservation de leurs métiers et emplois, moins habiles avec les nouvelles technologies…
Et si on se trompait complètement ? Selon plusieurs recherches récentes, les séniors auraient au contraire toutes leurs chances pour trouver leur place – et une bonne place dans l’ère IA. Décryptage.
Les séniors pas plus résistants au changement que les autres
Les « vieux » manifestent une plus grande résistance au changement ? Il est certes démontré que le vieillissement s’accompagne d’évolutions fonctionnelles et physiques susceptibles d’affecter la vitesse du cerveau et par conséquent de nuire à la flexibilité mentale. Mais cela se perçoit plutôt dans le grand âge que chez les personnes de moins de 65 ans et c’est un phénomène ralenti par l’activité professionnelle. Ouf ! on peut en tirer une première conclusion : rien ne prédispose biologiquement les séniors en entreprise à ne pas intégrer les nouvelles technologies et les nouveaux usages.
Mais alors, seraient-ils plus conservateurs, foncièrement attachés au « c’était mieux avant » ? Jusque dans les années 2010, la sociologie faisait un lien direct entre l’avancée en âge et le développement des idées conservatrices. Plus on vieillissait, plus on se repliait avec une certaine nostalgie sur les repères du temps où l’on représentait la jeunesse, quitte à en idéaliser les valeurs, les goûts, les pratiques… Oui, mais voilà, la donne a changé : les séniors d’aujourd’hui sont « moins inquiets et plus ouverts sur les évolutions de la société » que ne l’étaient leurs aînés et que ne le sont, sur certains thèmes, leurs enfants. dit le Credoc.
Bon, si on ne peut pas accuser la dégradation des capacités cognitives et pas non plus la tentation conservatrice, peut-on imaginer que leur position dans la société rende les séniors plus réticents à intégrer des transformations du travail ? La piste est plus probante : sont particulièrement averses au changement d’une part les strates de la population qui ont le moins de pouvoir et d’autre part celles qui en ont le plus. Les premières, parce qu’elles subissent le changement sans pouvoir faire œuvre d’agentivité pour influencer les nouveaux usages. Les secondes parce qu’elles trouvent trop davantage à leur situation pour percevoir l’intérêt du changement ! Il est alors envisageable de penser que les seniors en entreprises qui ont accédé à des postes à responsabilité à la force de l’ancienneté soient tentés de défendre un « vieux monde » qui leur convient plutôt que de concéder aux efforts nécessaires à s’adapter au « nouveau monde » qui vient. Mais cela ne dit rien de la capacité à intégrer les transformations technologiques et sociétales de tous ceux qui ont accédé à leur position en se mettant constamment en dynamique et qui occupent leurs fonctions en se remettant régulièrement en question. Bref, c’est plus une question de rapport au travail et à l’autorité qu’un sujet d’âge ou de génération.
Une génération X habituée au changement
En l’occurrence, la génération X correspondant aux cohortes nées entre 1965 et 1980 et qui représente actuellement les séniors en entreprises pourrait bien tenir une place à part dans le paysage des catégories générationnelles. Pour Cyril Cuenot, Directeur RH & transformation chez Sia Partners interviewé par Les Echos, les plus de 45 ans ont pour eux une solide habitude du changement. Ils ont vu passer une foultitude d’évolutions pratiques depuis leur naissance car leur ligne de vie se confond avec une époque de fulgurante accélération et de puissante massification de l’usage ordinaire des technologies. Ils ont intégré l’informatique dans leurs pratiques scolaires et professionnelles (oui, oui, il n’y avait pas d’ordinateurs à l’école en ce temps-là !), sont passés des usages fixes aux usages nomades (on leur raconte comment on téléphonait accroupis dans le vestibule, accrochés à un fil en tortillon ?), de l’encyclopédie à Internet… Ce n’est pas l’IA qui va leur faire peur !
Reste à savoir si on a de meilleures dispositions pour changer quand on a déjà eu de nombreuses occasions de s’adapter aux transformations ou si à l’inverse, à force de vivre des changements on serait comme gagné par une « change fatigue » qui rendrait l’effort de changer plus pénible. Convoquons les neurosciences pour en avoir le cœur net. Le cerveau est fainéant. Par nature. Il a toujours une préférence pour ce qu’il connait déjà, il aime les repères et les habitudes. C’est comme cela qu’il fonctionne le plus souvent, en vitesse 1 (ou système rapide) explique le Nobel Daniel Kahneman. Mais nous disposons aussi de la vitesse 2 (ou système lent) qui nous permet de penser et faire différemment, de casser nos rituels, de supporter l’aléa, de nous adapter à des contextes nouveaux. Problème : cela nous demande beaucoup d’efforts et nous fatigue beaucoup.
La bonne nouvelle, c’est que plus on fait travailler son « système lent », plus on augmente sa flexibilité cognitive et donc ses capacités à faire face à l’imprévu et aux modifications de notre environnement qui nous impactent. Autrement dit, avoir déjà eu plusieurs expériences d’adaptation au changement favorise l’agilité. Mais cela augmente aussi le niveau de conscience des efforts à fournir. Les séniors sont en quelque sorte moins naïfs que les plus jeunes face aux transformations : ils savent que le chemin d’acculturation pourra être long, parfois douloureux, fait de moments enthousiasmants mais aussi de phases plus effrayantes ou moins agréables.
Faire pencher la balance efforts/intérêts du bon côté
Dans ces conditions, les séniors ont probablement davantage besoin que l’on stimule leur motivation pour intégrer l’IA à leurs pratiques. Où il est question de balance efforts/intérêts qu’ils sauront juger favorable. Si l’IA les libère de tâches pénibles, ils y adhèreront plus volontiers que si elle réalise à leur place des tâches qui leur procurent du plaisir dans le travail, du sentiment d’expertise, de la fierté professionnelle, du ressenti d’utilité. C’est là qu’intervient la dimension générationnelle car ce qui peut apparaître pénible à des jeunes peut être un motif de satisfaction pour leurs aînés et vice versa.
Le rapport entre le processus et le résultat n’est effectivement pas le même selon que l’on a été socialisé à une époque où étaient valorisés l’approfondissement des savoirs par le travail et le talent pour les finitions ou à une époque où l’informatique produisant des résultats plus fiables plus rapidement que l’humain, on est surtout attendu sur ses capacités à « prompter » efficacement pour que la machine bosse bien. Autrement dit, le sénior qui aime « faire » son travail n’est pas forcément à l’aise avec le « travail fait » par une IA. Comme le junior qui a l’habitude valorisée de la simplification ne goûte pas toujours l’ordre de son vieux manager qui lui demande de passer par différentes étapes de production au nom des apprentissages que ce processus lui apportera.
Il apparait donc comme nécessaire d’envisager des usages différenciés de l’IA en fonction de critères non tant générationnels que de compétences & appétences. Demander à tout le monde de s’accorder sur ce qui est pénible ou ce qui est satisfaisant dans le travail est un pari impossible. Il est bien plus probable que chacun d’entre nous exploitera l’IA là où s’arrêteront ses savoirs & savoir-faire et s’en passera là où il trouvera des satisfactions, du sens et de l’expression de sa valeur ajoutée dans la réalisation directe du travail. C’est à la condition de stratégies RH adossées à la cartographie des compétences (acquises et à développer) des collaborateurs que l’intégration de l’IA dans les pratiques professionnelles se fera durable (au moins sur le plan humain. Sur celui des impacts environnementaux, c’est encore une autre problématique).
Vers l’heure de gloire des savoir-être ?
Puisque l’on parle de compétences, il est temps de se pencher sur celles que possède tout particulièrement la génération actuelle des séniors au travail, selon le récent rapport de France Travail consacré à l’inclusion des seniors en entreprise à l’ère de l’IA : les savoir-être. « Expérience, fiabilité, engagement, crédibilité, pédagogie, tact, sens de la collaboration, prise de risque : les qualités dont font preuve les séniors sont nombreuses et constituent un capital immatériel fondamental au sein d’une entreprise », dit l’institution qui pilote l’emploi en France. Et d’ajouter qu’il revient « aux communicants, aux directeurs des ressources humaines et aux organisations de valoriser [ces soft skills] pour briser le plafond de verre qui empêche ces salariés de se projeter dans l’avenir ». Comprendre : à l’ère IA, la question n’est pas seulement celle des nouvelles compétences à développer mais aussi celle des compétences intemporelles à préserver et à transmettre.
C’est d’autant plus crucial, indique le rapport, que l’IA est productrice d’accélération, d’immédiateté et de désintermédiation rendant plus que jamais nécessaires la prise de recul, l’anticipation, la vision stratégique et la capacité à se replier sur des plans B en cas de défaillance des systèmes connectés (un peu comme un conducteur qui a pris l’habitude des boîtes automatiques reste capable de piloter une boîte manuelle si nécessaire).
Les séniors n’ont donc pas dit leur dernier mot au travail : ils sont capables de s’adapter à l’IA comme ils sont capables de faire sans l’IA, ce qui rend particulièrement intéressant pour les entreprises de les employer judicieusement pour apprendre à tous à faire avec l’IA.
Marie Donzel, pour le webmagazine Octave
Share this Post