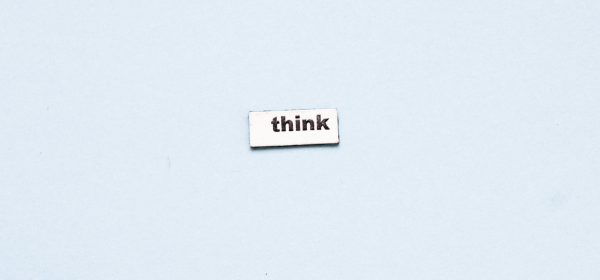Écrire à la main, un geste en voie de disparation ?
Écrire à la main, un geste en voie de disparation ?
Une question emblématique de l’enjeu des compétences du futur
Vous tapotez des SMS, vous échangez des « vocals », vous confiez peut-être à une IA le soin de prendre les notes de vos réunions, vous promptez à l’oral votre agent conversationnel préféré et si vraiment vous avez besoin de rédiger un texte plus long, il y a fort à parier pour que vous le pianotiez sur un clavier plutôt qu’avec une plume d’oie sur un cahier. Le marché de la carte postale s’est effondré, celui de l’agenda et du bloc-notes n’est pas en grande forme et la dystonie de la main (ou « crampe de l’écrivain ») est une affection qui concerne désormais surtout les musiciens. Le constat est clair : l’écriture manuscrite n’a plus la place qu’elle a connu. Elle serait même en voie de disparition. Une simple évolution anthropologique consécutive des transformations technologiques ? Assurément, mais aussi tout un symbole de la question des compétences d’avenir. Décryptage.
Une pratique antique, technologique et dynamique
Les historiens font remonter l’invention de l’écriture à environ quatre millénaires avant notre ère. Depuis ses débuts, l’écriture a maille à partir avec la technologie au sens propre du terme : la médiation de l’intention humaine par l’outil. Aussi, l’histoire de l’écriture, c’est celle des techniques, des supports et des instruments autant que celle des processus codifiés, des pratiques et des documents. De ce fait, l’écriture n’a cessé de se transformer au cours du temps : elle n’est pas la même au temps des tablettes de grès, à l’ère de l’imprimerie ou à celle de l’informatique.
Puisque les technologies exercent un pouvoir d’influence civilisationnel, il faut faire le constat que l’on n’écrit pas la même chose de la même façon aux différentes époques de cette longue histoire. Pour exemple, dans les années 1980 une question taraudait le monde de l’édition : est-ce qu’avec la massification de l’ordinateur personnel, le style des écrivains allait changer ? La réponse a été donnée : oui. La transformation d’un processus de production opère une transformation du produit lui-même. Mais cela n’a pas supprimé la littérature, bien au contraire car en réduisant le coût et la durée du cycle éditorial à tous ses chaînons (de l’écrivain à l’éditeur), la démocratisation de la dactylographie a contribué à l’inflation du volume de publications.
La perte de l’écriture manuelle est-elle un problème ?
Néanmoins, la généralisation du travail sur ordinateur, celui de l’écrivain comme celui de toute personne ayant besoin pour sa pratique professionnelle de coucher des mots a assurément fait reculer l’usage de l’écriture cursive. Il n’y a guère qu’à l’école qu’on l’utilise encore tous les jours. Mais cela pourrait changer aussi : en 2013, l’apprentissage manuel de l’écriture dans l’enseignement primaire devenait facultatif dans 45 États des Etats-Unis. Trois ans plus tard, seuls 12 États persévérait à obliger les enfants à tenir un crayon. Toutefois, 10 États qui avaient renoncé à cet apprentissage ont depuis décidé d’y revenir.
Mais pourquoi donc ce retour en grâce de l’écriture dans les classes ? Pour éviter la tricherie aux examens, avancent certains. Pour continuer à outiller les individus dans une société qui n’a pas encore vu totalement disparaître l’utilité du stylo, disent d’autres qui s’alarment de la perte de fait de droits tels que le vote quand il apparait que 3% des électeurs californiens aux dernières élections présidentielles ont vu annulée leur participation au scrutin car ils n’avaient pas été capables de produire une signature valide. Il en va bien de justice sociale quand par ailleurs, on apprend que les patrons de la Silicon Valley sont les premiers à scolariser leur progéniture dans des établissements sans écran où l’on apprend à l’ancienne, avec des livres, du papier, de l’encre et surtout des profs en face des élèves !
Est-ce à dire que l’on apprend moins bien quand on n’apprend qu’avec des outils digitaux ? Les optimistes seront tentés de répondre : non, non, on apprend différemment. Mais c’est oublier que la digitalisation des apprentissages va souvent de pair avec l’individualisation du processus d’acquisition des savoirs, si ce n’est la solitude de l’apprenant. C’est surtout passer à côté de l’apport en termes de facultés cognitives, physiques et psychiques des différentes modalités d’apprentissages.
Ce qui se passe quand on écrit à la main
Si le spectre de la disparition de l’écriture manuelle inquiète, c’est avant tout parce que le geste n’est pas du tout anodin dans le développement et le maintien de tout un ensemble de compétences qui vont de la motricité fine à la mémorisation en passant par l’attention, l’anticipation, l’empathie et l’expression de la personnalité.
La motricité fine, c’est l’ensemble des mouvements précis, coordonnés et contrôlés des mains qui sont mis en œuvre dans la réalisation d’un geste intentionnel. Déverrouiller une serrure à l’aide d’une clé, faire ses lacets ou emboîter des pièces de Lego, c’est de la motricité fine. Écrire en tenant un crayon, c’est de la motricité fine avancée. Il se passe dans notre cerveau tout un parcours décisionnel complexe allant de l’élaboration de l’idée jusqu’à l’exécution de tout une recette de gestes (43 muscles sont mobilisés !) impliquant le positionnement du support, la tenue du crayon, le dosage de l’intensité du marquage, l’attention à l’horizontalité des suites de lettres et à la régularité de leurs dimensions etc. Le cerveau bosse beaucoup quand on écrit à la main !
Il travaille d’autant plus qu’il est mobilisé dans ses facultés d’anticipation Il lui faut penser la suite des lettres pour former un mot, mais aussi la suite des mots qui vont composer la phrase car le coût de l’erreur est extraordinairement plus élevé que lorsqu’on pianote sur un clavier en profitant de la possibilité d’effacer plusieurs fois, de faire des ajouts, des insertions, des copiés-collés. La pratique de l’écriture manuscrite contribuerait ainsi à entraîner notre art de tourner trois fois notre idée dans notre tête avant de l’exprimer. C’est plutôt un bon exercice pour réduire les risques de biais et stimuler son sens de la responsabilité des discours produits. Imaginez un instant que tous les contributeurs des réseaux sociaux doivent écrire leurs 140 signes à la main chaque fois qu’ils ont envie de délivrer un message : il se peut qu’au cours de ce processus, beaucoup renoncent finalement à adresser au monde des propos dont l’utilité et les bénéfices sont discutables quand ils ne sont pas carrément délétères.
Car ce que l’écriture manuscrite fait aussi travailler, c’est l’empathie. Ce n’est pas toujours flagrant quand vous consultez l’ordonnance de votre médecin, mais ça l’est beaucoup plus quand l’instituteur écrit au tableau : quand on écrit, on doit se rendre lisible ! L’écriture scripturale sur nos claviers supprime ce souci. C’est une chance pour ceux qui écrivent comme des cochons et pourront malgré tout être lus en police Times ou Garamond, mais c’est une occasion manquée de s’entraîner à prendre en compte le point de vue de l’autre quand nous exprimons notre volonté. Il y a d’autres façons, évidemment, de muscler son empathie. Il nous faut seulement veiller à ce que nos nouveaux usages en créent au moins autant qu’ils en font disparaître.
Penser nos pratiques d’apprentissage et de transmission en termes de processus
Il est donc clair que l’écriture manuscrite, savoir-faire plurimillénaire, est un marqueur civilisationnel majeur en même temps qu’une pratique riche pour l’intelligence humaine. Mais il serait absurde d’en concevoir le retour de l’hégémonie ailleurs que dans la littérature contre-utopique qui imagine le monde post-effondrement où il nous faudrait vivre sans technologies.
En revanche, il est tout à fait pertinent de nous intéresser à ce qui se joue dans les évolutions des pratiques d’apprentissage des savoirs, de communication des messages et de transmission des compétences. Quand un texte est produit par l’intermédiaire d’un stylo, d’un clavier ou d’une IA, il ne se passe pas la même chose même s’il semble que le résultat puisse être le même, modulo une rapidité d’exécution qui va du simple au (largement) plus que centuple, une propreté et une lisibilité sans commune mesure, des conditions de partage radicalement différentes. La balance semble alors clairement pencher du côté de l’outillage technologique le plus avancé. Mais uniquement si l’on mesure la qualité à l’aune du résultat, sous l’angle de sa rentabilité immédiate. Si l’on se préoccupe de la qualité du processus et de tout ce que celui-ci produit d’externalités positives conscientisées ou non, notamment en termes de développement des compétences, d’ajustement des postures et de vivre-ensemble, il faut probablement travailler à identifier le juste équilibre entre l’intelligence humaine et l’intelligence artificielle.
Marie Donzel, pour le webmagazine
Share this Post