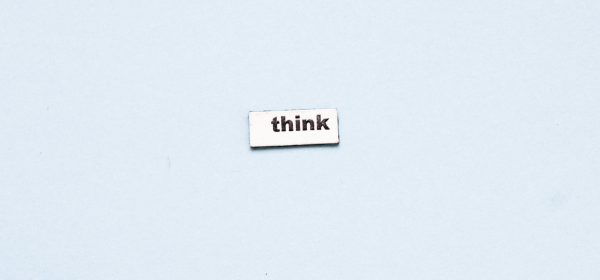Les « nouveaux jeunes » moins préoccupés par le sens au travail ?
Les « nouveaux jeunes » moins préoccupés par le sens au travail ?
Les Millenials ont nettement marqué les entreprises au cours de la dernière décennie en adressant une demande aigue de sens au travail. Entre besoin de se sentir utile, exigence de congruence, volonté d’influencer le monde économique pour qu’il soit davantage contributeur à la justice sociale et à la transition environnementale, rejet des « bullshit jobs » et glorification des métiers du « faire », aspiration à la coopération et on en passe, les natifs des années 1980-1990 ont sans doute été les « jeunes » les plus philosophes de l’histoire du monde du travail. Ils vont à présent manager les génération Z et alpha, avant que les Bêtas ne débarquent. Et l’on commence à découvrir que les « nouveaux jeunes », nés à partir de la fin des années 1990 ont peut-être plus de points communs avec les boomers qu’avec la GenY.
Greta n’est pas si représentative qu’on le croit
« Que veulent vraiment les étudiants des grandes universités ? » titrait récemment le New York Times. Et d’y répondre en direct du campus d’Harvard : devenir riche.
Pour le journaliste, il y a de quoi affirmer avec une certaine ironie que la figure de Greta Thunberg et des activistes de la justice sociale et climatique qui font la une des médias sont en réalité une minorité qui flatte l’esprit des trentenaires et quadragénaires bercés par l’idée que les nouvelles générations vont faire mieux et pousser les vieux à rejoindre le monde qu’ils auront réussi à changer.
Ils ne sont au fond pas si nombreux, les jeunes, à rêver de rejoindre une ONG, à se projeter en « écotafeurs » ou en « change maker », à viser une boîte à taille humaine dont la chaîne de valeur courte et transparente serait le gage d’un impact palpable. Au lieu de cela, « un nombre croissant d’étudiants recherchent l’imprimatur d’un emploi dans une entreprise puissante pour se faire un paquet d’argent le plus rapidement possible ».
Des « boomers » comme les autres ?
Il faut regarder le temps long des motivations au travail pour se rendre compte que dans les pays occidentaux, jusqu’à la fin des années 1970, le premier critère pour déterminer la qualité d’un job, c’était la rémunération. Des années 1980 à 2010, ce critère entrait en compétition sérieuse avec d’autres motivations comme l’intérêt du poste, le prestige du secteur, les conditions de travail (tout particulièrement en termes d’articulation des temps de vie). Sur la décennie 2010, la rémunération se faisait carrément tailler des croupières par le « sens » avec une part non-négligeable de diplômés prêts à gagner moins en contrepartie du sentiment d’être utiles, d’être fiers des engagements sociétaux de leur entreprise, de participer à des projets incarnant un idéal d’avenir et de faire tout cela dans un environnement de travail pensé pour l’épanouissement des individus. Ce furent les grandes années des fonctions intrinsèques identifiées par la psychologue sociale Marie Jahoda et modélisées le sociologue Edward Deci, c’est-à-dire de toutes les raisons de se lever le matin autres que la seule nécessité de gagner sa vie.
Mais depuis 2020, la fonction extrinsèque, autrement dit la rémunération, fait son grand retour en force pour atteindre un degré de priorité semblable à celui d’il y a 50 ans ! Si on y ajoute le fait que nos amis les Z aspirent à la sécurité de l’emploi et n’ont rien contre l’esprit « corporate », on serait tenté de les inviter à une conversation avec leurs grands-parents sur le rapport au travail. Peut-être bien que boomers et vingtenaires sont finalement faits pour s’entendre sur le thème « le CDI bien payé, c’est la vie ! »
Touche pas à ma santé mentale !
Pas si vite ! Parce que si 84% des « nouveaux jeunes » ont le goût du travail et que 73% sont prêts à réaliser des tâches qui ne sont pas inscrites sur leur fiche de poste en contrepartie de la sécurité offerte par l’entreprise, selon les dernières données produites par l’observatoire sociétal des entreprises IPSOS-BVA, il y a une limite à ne pas franchir : celle de la santé mentale. Plus de 7 GenZ sur 10 disent souffrir de troubles de l’anxiété, dont 15% les qualifient d’intensité sévère.
Sensibilisés aux risques psychosociaux, ils sont 72% à accuser les relations de travail d’être responsables d’une détérioration de leur état psychologique, selon l’édition 2025 du baromètre UKG. Mais que les employeurs ne se sentent pas spécialement montrés du doigt car de façon générale, les « nouveaux jeunes » corrèlent le sentiment de mal-être des individus aux insuffisances des institutions (l’école, l’État, les médias, les réseaux sociaux…) à les protéger…
Un gros besoin de sécurité
Les Z veulent donc la sécurité financière, la sécurité de l’emploi (quitte, paradoxalement à changer de job souvent pour trouver la boîte qui offrira les meilleures perspectives de pérennité) mais plus globalement des garanties auxquelles adosser leur confiance en l’avenir.
Ainsi, ils entretiennent un rapport moins romantique à l’environnement que leurs aînés les Y, mais sont attentifs à être préservés des effets de la pollution, des conséquences du dérèglement climatique, des risques sanitaires. Et ce, de façon très pragmatique : gardez-leur une chambre chez papa-maman en cas de confinement, fournissez les masques, envoyez les plans anti-canicules, faites le plein du frigo en nourriture bio, ne laissez pas le moteur tourner sous leur nez, prévenez-les en cas de tempête annoncée. Bref, qu’on leur laisse une planète en sale état, ils s’habituent à ne pas s’y faire, mais pas question qu’ils en paient le prix de leur santé et de de leur sécurité.
Génération dépolitisée ?
Cette approche plus assurantielle que transformative fait volontiers dire que les « nouveaux jeunes » sont dépolitisés. Ils ne seraient cependant pas les premiers, puisqu’un même reproche était fait au X qui boudèrent les syndicats et aux Y qui se détournèrent des urnes. Mais c’est peut-être surtout un contre-sens car les Z pourraient bien être la génération du grand retour aux valeurs politiques les plus traditionnelles.
A commencer par le patriotisme quand 57% des Français de moins de 25 ans (y compris les filles à hauteur de 46%) se déclarent prêts à s’engager en cas de guerre sur le sol français. Faut-il relier cela à la remontada du virilisme qui s’observe au travers d’un « gender gap » plus vertigineux que jamais entre le progressisme sociétal des jeunes femmes et le néoconservatisme des jeunes hommes ? D’aucuns, comme le réalisateur Martin Weill vont jusqu’à parler de « nouveaux réacs » pour qualifier une portion de la jeunesse particulièrement sensible aux figures d’autorité, au leadership de posture martiale, aux discours intransigeants. Mais d’un autre côté, la jeunesse n’a jamais été aussi anti-raciste, indiquent les résultats de l’étude menée en 2025 par la Commission nationale consultative des droits de l’homme.
Il faut sans doute comprendre de ce tableau contrasté jusqu’à l’empilement des paradoxes que la « nouvelle jeunesse » est avant tout en quête de repères. Et que ce n’est qu’à la condition de regagner une forme de stabilité qu’elle pourra se reposer la question du « sens ». Au travail comme dans le reste de l’existence.
Marie Donzel, pour le webmagazine EVE
Share this Post