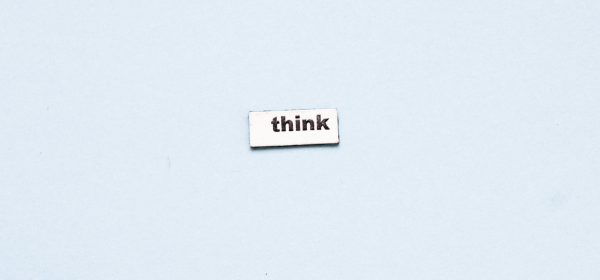C’est quoi l’antifragilité ?
C’est quoi l’antifragilité ?
La crise économique de 2008, la pandémie mondiale du COVID-19, la crise climatique, les bousculements politiques mondiaux… Ces chocs ont des impacts qui souvent déconcertent. Et parfois produisent du renforcement positif, via des réflexes d’adaptation, d’innovation, de transformation.
Cette dynamique spécifique a été décrite par Nassim Nicholas Taleb dans son ouvrage Antifragile, les bienfaits du désordre. Zoom sur le concept d’antifragilité.
Quelle différence entre résilience et antifragilité ?
Le concept d’antifragilité se réfère à la capacité de certains individus, organisations ou systèmes à non seulement résister aux stress et aux chocs, mais à en sortir renforcés. L’antifragilité diffère de la résilience, qui amène les individus à revenir à leur état initial après une perturbation. L’antifragilité porte sur les « bienfaits » des chocs et du désordre.
Les bienfaits attendus sont de trois ordres :
- Amélioration continue: L’antifragilité permet à la fois de survivre aux crises, et de croître en s’améliorant grâce à elles.
- Résilience renforcée: En adoptant des principes antifragiles, les organisations et les individus deviennent davantage capables de gérer l’incertitude et les perturbations.
- Innovation et créativité: En utilisant les perturbations comme des sources d’apprentissage et de découverte, les systèmes antifragiles se retrouvent souvent à l’origine de l’innovation.
De la résistance aux chocs au bénéfice des chocs
La grande majorité des individus et des organisations sont fragiles, c’est-à-dire averses aux imprévus et les chocs. Sapiens préfère le confort, la sécurité et la visibilité à la perturbation et aux turbulences. Pour autant, ce même Sapiens témoigne d’une capacité d’adaptation sur le temps long comme l’a mis en évidence Darwin mais aussi à très court terme.
Par exemple, lors d’une conversation en visioconférence, si le son grésille, la concentration de notre écoute va augmenter. Nous bénéficions ainsi du choc auditif. Notre compétence auditive se révèle supérieure, au bénéfice de notre capacité de compréhension. Le bénéfice du « choc » que représente le grésillement s’inscrit ensuite dans la durée, à travers notre meilleure aisance à mobiliser des forces de concentration dans les environnements bruyants mais aussi ceux qui nous distraient, nous parasitent, nous mettent en inconfort.
Accepter l’incertitude
A travers leurs compétences de flexibilité structurelle, d’adaptation et leur culture favorisant l’innovation continue, les individus et les organisations sont capables de tirer parti des opportunités et des perturbations pour se renforcer et se développer.
Au niveau individuel, Tal Ben-Sahar explique que dans des circonstances difficiles, les individus échappent à la tentation du désespoir quand ils entrevoient la possibilité d’apprendre et d’évoluer grâce aux épreuves qu’ils traversent. Accepter l’incertitude avec la certitude de son potentiel d’antifragilité peut donc conduire à une amélioration de la santé mentale et du bien-être des individus.
Antifragile, jusqu’où ?
Selon François Chamaraux, docteur en sciences, enseignant en mathématiques et sciences, tout système antifragile ou résilient qui serait trop agressé finirait cependant par devenir fragile. Il estime ainsi que rien ne résisterait à des chocs trop grands. Une plante dont on supprime les bourgeons tous les jours est vouée à mourir. Une forêt abattue sur une surface trop importante verra son sol lessivé par les pluies, et ne pourra plus repousser. Dormir dehors par -30 °C n’aide pas à supporter le froid de la journée suivante. Une personne que l’on soumet incessamment au bruit qui nuit à sa concentration verrait sa santé auditive et sa santé mentale affectées.
Aussi, les études sociologiques nous apprennent que les individus ne sont pas égaux face à la fragilité et la vulnérabilité. Aussi, celle-ci peut augmenter ou diminuer selon les mesures mises en place au sein du système dans lequel ils évoluent. Les personnes malades, en situation de handicap, âgées ou en difficultés sont ainsi exposées à des plus grandes fragilités.
En conscience de cela, il y a deux présupposés sur la vulnérabilité qui gagnent à être déconstruits.
- La vulnérabilité n’est pas une prédisposition à être affecté par un évènement préjudiciable externe. Ce sont des événements liés aux circonstances internes du système, notamment le fait d’être discriminé ou exclu, qui exposent les individus à la fragilité.
- La vulnérabilité ne se confond pas avec l’incapacité d’agir. Selon Joan Tronto, professeur de théorie politique, la résistance aux chocs et au stress des populations dépend avant toute chose de la capacité de l’organisation à renforcer leur autonomie.
Autrement dit, l’antifragilité n’est pas exigible des individus. Elle est le fruit de la capacité d’un système (société, entreprise, famille…) à leur offrir des conditions propices au déploiement de leurs forces de transformation. Cela repose notamment sur un environnement de confiance et de sécurité psychologique.
Charlotte Foulon et Marie Donzel, pour le webmagazine Octave
Share this Post