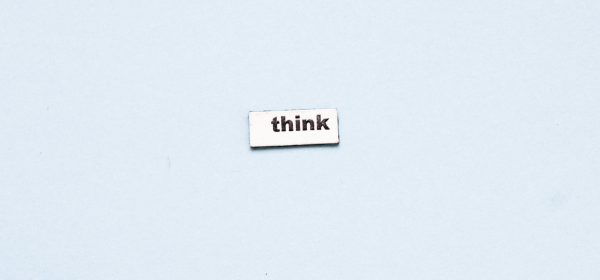À quel âge devient-on senior en entreprise ?
À quel âge devient-on senior en entreprise ?
« Handicap », « black », « senior »… Quand certains mots risquent de heurter les sensibilités, les anglicismes viennent souvent au secours de la langue française. Le terme « handicap » a traversé la Manche au XIXe siècle pour remplacer « infirmité », tandis que « black », apparu dans les années 1980, s’est imposé comme un syonyme de « noir », comme l’explique la sémiologue Marie Treps. La question de la vieillesse ne déroge pas à la règle. De la même manière, des termes comme « senior » ou, plus récemment, « silver » se sont en effet glissés dans notre vocabulaire pour adoucir la réalité qu’ils désignent. Mais à force de multiplier ces pirouettes sémantiques, ne risquons-nous pas d’en oublier le sens réel ?
Car qu’on le veuille ou non, une vérité s’impose à tous : un jour, nous serons confrontés à la vieillesse. Une étape naturelle de l’existence, mais aussi un sujet parfois tabou, notamment dans le monde du travail. Dès lors, ne serait-il pas temps de nommer les choses clairement et de préciser ce que recouvre réellement le terme « senior » ? Et surtout, à quel âge le devient-on en entreprise ?
Pour répondre à ces questions, les équipes du Programme Octave ont mené l’enquête.
Être sénior : une question de perception et de contexte
D’après le dictionnaire Le Robert, un « senior » est une personne de plus de cinquante ans. L’Organisation mondiale de la santé (OMS), quant à elle, fixe la barre à 60 ans. En revanche, dans le domaine sportif, on entre dans la catégorie senior entre 18 et 40 ans selon les disciplines, avant d’accéder au statut de « vétéran ».
Pour le sociologue Vincent Caradec, réduire le vieillissement à une question d’âge est une erreur. Il prône une approche plus large, tenant compte des pratiques et modes de vie. L’utilisation du temps libre diffère ainsi entre un quinquagénaire et un octogénaire, rendant toute définition uniquement basée sur le fait d’être âgé de plus de 50 ou 60 ans obsolète.
Dès lors, comme le disait le sociologue Pierre Bourdieu à propos de la jeunesse en 1978 : « La vieillesse n’est qu’un mot ». Elle relève de constructions sociales et culturelles variant selon l’époque, la société et l’environnement social.
Un regard social sur la vieillesse dans nos sociétés
Quel que soit l’âge auquel on devient officiellement « senior », une tendance se dessine : la population française vieillit. Depuis 2011, ce phénomène s’accentue et, selon l’Insee, en 2050, plus d’un tiers de la population de la France métropolitaine aura plus de 60 ans. En 2000, ils étaient un sur cinq.
Et pourtant, les représentations négatives de la vieillesse perdurent dans nos sociétés occidentales contemporaines. D’après, Bernard Ennuyer, docteur en sociologie de la vieillesse et du vieillissement, il existe dans nos sociétés, depuis la fin du XVIe siècle l’idée que la vieillesse est “un mal, une infirmité (voire une maladie), un âge triste qui prépare la mort”.
Cette vision, selon la sociologue Jacqueline Trincaz, trouve ses racines dans les mythes grecs et les récits bibliques, qui véhiculent une vision peu flatteuse de la vieillesse et qui se sont beaucoup développés à l’époque de la Renaissance. Dans le mythe de Pandore, par exemple, Zeus envoie Pandore sur Terre pour punir les hommes de leur orgueil. Elle apporte ainsi « les maladies cruelles que la vieillesse apporte aux hommes ». À l’inverse, dans le mythe de la fontaine de Jouvence, le rajeunissement devient une quête capitale.
Senior et entreprise : une relation complexe
Avec l’allongement de l’espérance de vie et le report de l’âge de la retraite, les seniors sont amenés à rester dans l’entreprise plus longtemps. Pourtant, le monde du travail reste marqué par l’âgisme, un terme inventé en 1969 par le gérontologue Robert Butler pour décrire un « profond désordre psychosocial caractérisé par des préjugés institutionnalisés, des stéréotypes et une mise à l’écart des seniors ».
D’après le rapport Seconde Partie de Carrière d’Alternego, réalisé en 2023 sur plus de 10 000 personnes, 25 % des salariés de 60 ans et plus estiment avoir déjà subi une discrimination liée à leur âge. Les enseignants-chercheurs Sana Guerfel-Henda et Jean-Marie Peretti, auteurs de Le senior, objet de discrimination à l’embauche ?, soulignent que cette discrimination s’illustre notamment par un accès restreint aux formations longues préparant à des évolutions professionnelles et promotions. Elles seraient jugées peu rentables pour les employeurs car la durée d’amortissement de la formation serait trop courte.
Pourtant, les études sont unanimes, les discriminations liées à l’âge ont des conséquences négatives profondes sur l’entreprise. En freinant l’accès aux opportunités et en véhiculant des stéréotypes, elles contribuent à une détérioration du bien-être au travail, à une perte de motivation des salariés concernés et, plus largement, à la création d’un environnement de travail non-inclusif. Et au-delà du coût social, le coût sur la performance économique de l’entreprise n’est pas des moindres. En effet, aux Etats-Unis, selon un rapport de l’AARP et de l’Economist Intelligence Unit publié en 2020, les préjugés à l’encontre des travailleurs âgés auraient coûté à l’économie américaine environ 850 milliards de dollars en produit intérieur brut.
Pour combattre l’âgisme, il faut repenser la vieillesse, sans euphémisme ni fantasme
Face à l’âgisme, le rapport mondial de l’agisme, publié en 2021 par l’OMS, préconise plusieurs solutions : des politiques publiques contre la discrimination, des activités éducatives pour dissiper les fausses idées, et des interactions intergénérationnelles pour réduire les préjugés comme le mentorat intergénérationnel.
Mais au-delà des initiatives institutionnelles, c’est l’ensemble de la société qui doit repenser son rapport à l’âge. Certaines initiatives vont dans ce sens. Anne Thévenet-Abitbol et Charlotte Darsy ont ainsi créé le mouvement « NOLD » (neverold) dont l’objectif est de prouver que ce n’est pas parce que les années passent que l’on ne peut plus user d’humour et de légèreté. Et les seniors eux-mêmes participent à ce changement de regard. Dans la pop culture, le documentaire Arte Granfluencers : les seniors cartonnent sur les réseaux sociaux, publié en avril 2024, met en lumière des figures senior inspirantes, telles que Licia Fertz, considérée comme l’influenceuse italienne la plus âgée, ou Günther Krabbenhöft, aussi appelé le doyen des hipsters berlinois. En France, Danielle Renault (Studio Danielle) fait office de précurseuse avec sa chaîne YouTube créée en 2015 qui rassemble aujourd’hui presque 2 millions d’abonnés qui suivent son quotidien.
Finalement, ces représentations rappellent que l’âge ne doit pas être un tabou, mais une réalité assumée et valorisée. Nommer l’âge avec lucidité, loin des euphémismes et des fantasmes, c’est aussi reconnaître la place essentielle des seniors dans nos sociétés. Car, comme le dit l’adage : on est toujours le vieux de quelqu’un, une réalité qui ne traduit finalement qu’une position relative au sein d’un groupe social et dans un contexte donné.
Gabrielle Pastel pour Octave
Share this Post